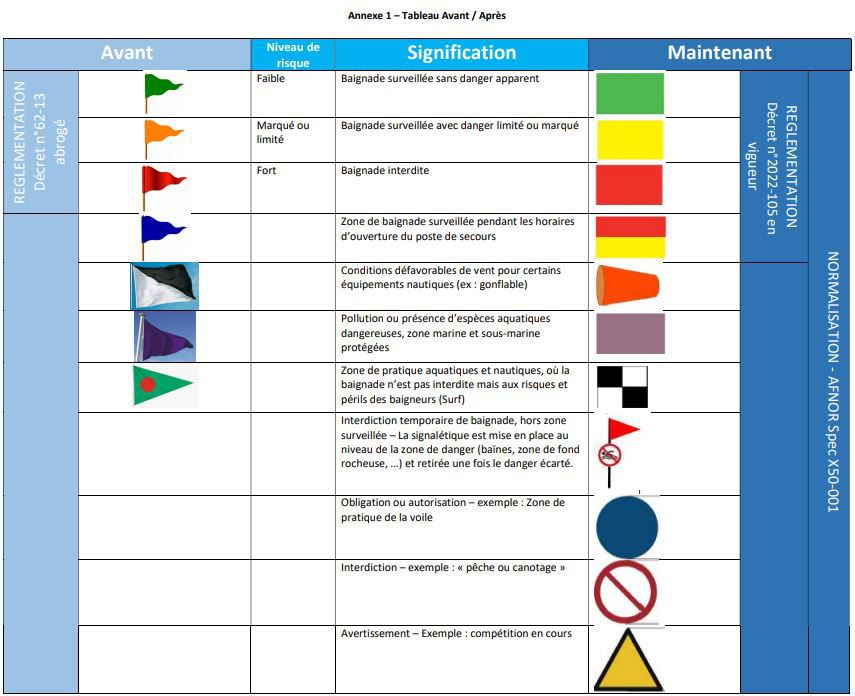La Teste-de-Buch : sauver ce qui peut l’être après l’incendie
Il y a deux mois, un gigantesque incendie ravageait la forêt de pins située aux alentours de la commune girondine. L’ONF dresse un premier bilan et trace ses perspectives.
Olivier Sorondo – 3 octobre 2022 – Dernière MAJ : le 4 octobre 2022 à 19 h 49 min

Un environnement dévasté
À la faveur des quelques précipitations qui ont arrosé la Gironde ces derniers jours, l’incendie de la Teste-de-Buch a été déclaré officiellement éteint par les autorités. En juillet, le feu a ravagé plus de 7 000 hectares de forêt ainsi que des campings, des restaurants et des habitations.
Toujours interdite au public par mesure de sécurité, la zone comprise entre la dune du Pilat et Biscarrosse s’est transformée en paysage lunaire, royaume des troncs noircis et des fougères calcinées.
Pour l’ONF (Office National des Forêts), il convient de s’organiser entre action urgente et réflexion à plus long terme.
Dans l’immédiat, les agents se chargent d’un premier nettoyage du millier d’hectares brûlés de la forêt domaniale. Selon les estimations de l’institution, près de 400 hectares de pins incendiés devront être abattus, nécessitant d’engager une trentaine d’engins forestiers. L’objectif prioritaire consiste à éviter un développement trop important des champignons, qui bleuissent les troncs, et surtout des scolytes, insectes réputés pour creuser des galeries sous l’écorce afin d’y déposer leurs œufs. Les pins n’y survivent généralement pas.
« Dans un écosystème de pins, le scolyte peut augmenter de 10 % à 30 % le volume de bois mort. On va essayer de le limiter à 10 % » déclare Francis Maugard, expert en pin maritime, au journal Le Monde (03/10).
Il s’agit aussi de récupérer un maximum de matières afin que le bois soit utilisé par la filière et les professionnels de la transformation. Même si les pins ont été brûlés en surface, « le bois à l’intérieur n’est que peu altéré et donc il est encore utilisable. Mais plus on va attendre, moins il sera exploitable » explique Yann Rolland, responsable du service bois pour l’agence ONF, dans les colonnes de Ouest France (26/09).
D’ici la fin du mois de décembre, plus de 80 000 mètres cubes de bois devraient être récupérés et valorisés (contreplaqué, lambris, emballages, palettes). Ce niveau correspond à huit fois le volume d’une année normale.
Une étude attentive du terrain
La mission de l’ONF consiste également à anticiper le futur aménagement de la forêt. Il s’agit en premier lieu de préserver les pins les moins touchés par le feu, dès lors que des aiguilles vertes continuent d’orner leur branches.
« Si un pin meurt dans un ou deux ans, mais qu’il donne d’ici là une dernière pluie de graines, qui pourra favoriser la régénération naturelle, c’est déjà ça » estime Fabrice Carré, technicien, cité par Le Monde.
Les associations environnementales considèrent pour leur part que la renaissance naturelle de la forêt se retrouve perturbée par les travaux de l’ONF : « Les arbres, les fougères, les herbes, tout est en train de repousser en beauté, même les arbustes. La moindre intervention lourdement mécanisée va porter un préjudice absolument gravissime à cette reviviscence naturelle » déplore Françoise Brangré, membre de l’association Bassin d’Arcachon Écologie, interrogée par France Info (01/10).
De fait, la nature semble déjà reprendre ses droits. Des fougères ont fait leur réapparition et des repousses sont observées au pied des arbres. La faune n’a pas disparu non plus, comme l’atteste la présence de renards, de lièvres et de chevreuils. Le retour d’espèces plus rares, à l’instar du lézard ocellé ou du petit pessereau, continue de susciter des interrogations.
Enfin, si la prochaine saison touristique n’est pas considérée aujourd’hui comme un objectif prioritaire, l’ONF anticipe quand même la réouverture des plages du Petit Nice, de la Lagune et de la Salie, au sud de la dune du Pilat.
« Il va falloir mettre l’ensemble des financeurs autour de la table. On a commencé à faire des estimations. Pour rouvrir ces sites, c’est à minima 1 million d’euros » souligne Cédric Boucher, le responsable du site, au micro de France Bleu (27/09). La plage de la Lagune pourrait être desservie par des navettes et les estivants seraient encouragés à utiliser leur vélo pour rejoindre leur spot favori. Il faudra au préalable rouvrir la D218 entre le Pyla et Biscarrosse, toujours fermée en raison des travaux de sécurisation.
L’incendie laissera des traces pendant encore de nombreuses années.