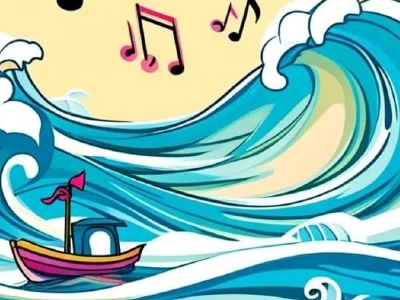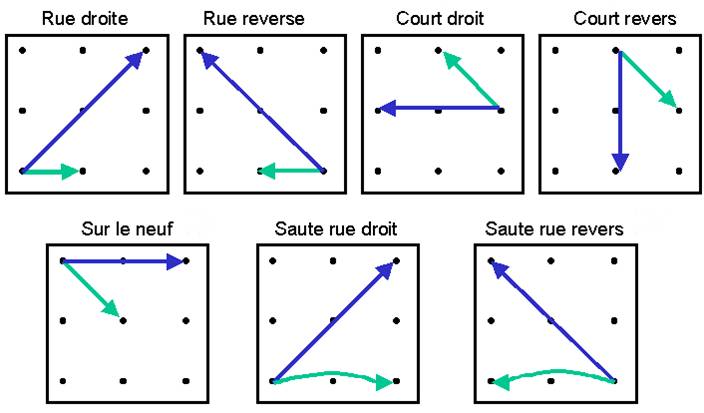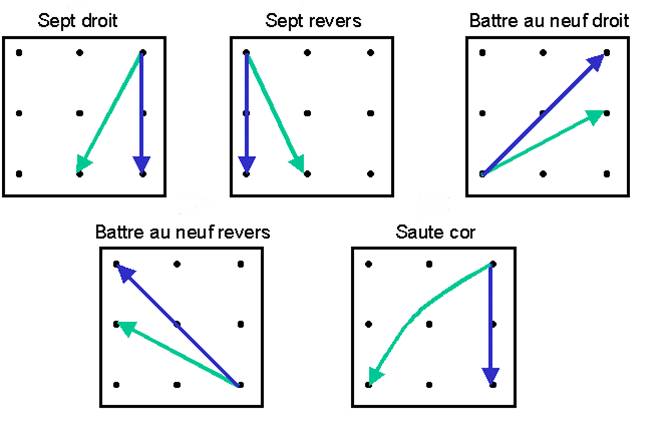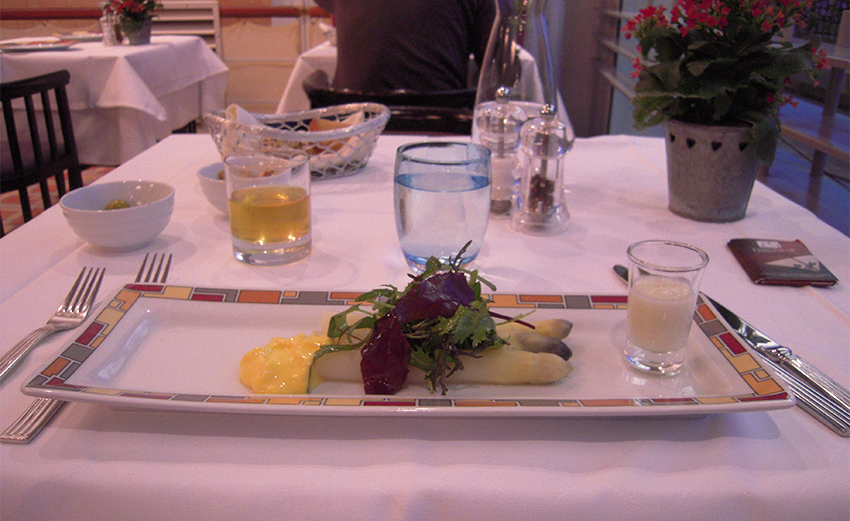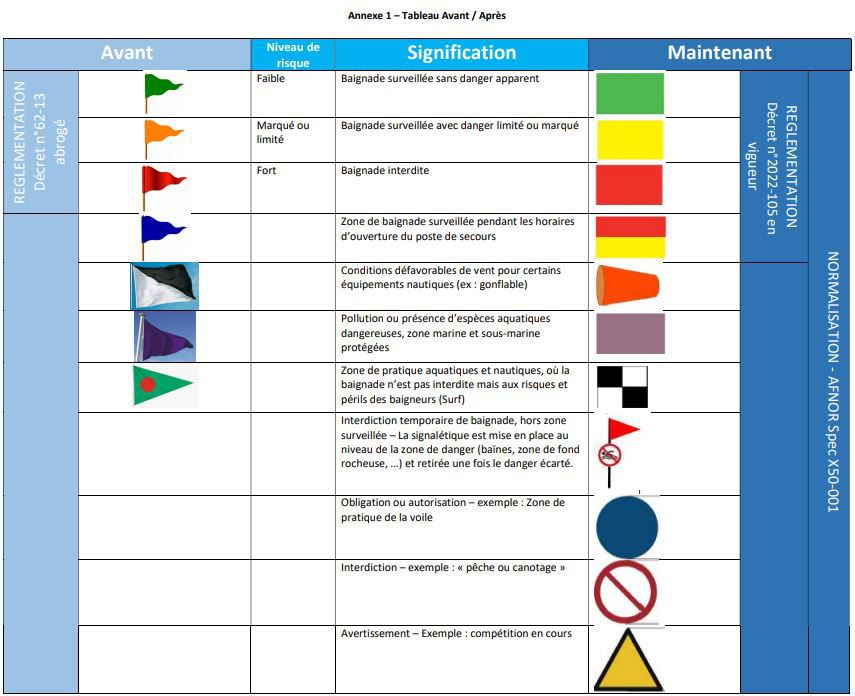Qu’il fait bon admirer les étoiles dans les Landes de Gascogne !
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne vient d’obtenir le prestigieux label Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE).
Olivier Sorondo – 4 avril 2025 – Dernière MAJ : le 5 avril 2025 à 17:16

Sixième réserve labellisée en France
Ce n’est quand même pas rien. L’association internationale Dark Sky vient d’attribuer son label RICE au Parc naturel régional (PNR) des Landes de Gascogne. Ce label, attribué le 12 février 2025, fait de ce parc la 6e réserve de ce type en France et la 22e dans le monde, mais également la première située en plaine. Comme le rappelle le site officiel des parc nationaux, « un territoire labellisé RICE bénéficie d’un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle qui fait l’objet d’une mise en valeur à des fins scientifiques, éducatives, culturelles, touristiques ou dans un but de préservation de la nature. Chaque réserve comprend une zone centrale où la noirceur naturelle est préservée au maximum et une région périphérique où les élus, les individus et les entreprises reconnaissent l’importance du ciel étoilé et s’engagent à le protéger à long terme. »
Le PNR des Landes de Gascogne rejoint donc les cinq réserves labellisées en France :
Pic du Midi de Bigorre (2013)
- Première RICE en France et en Europe.
- Située dans les Hautes-Pyrénées, elle s’étend sur 3 000 km² et est cogérée par le Parc national des Pyrénées, l’établissement du Pic du Midi, et le syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées.
Parc national des Cévennes (2018)
- Plus vaste RICE d’Europe avec une superficie de 3 560 km².
- Reconnu pour la qualité exceptionnelle de son ciel, comparable à celui du désert d’Atacama.
Alpes Azur Mercantour (2019)
- S’étend sur 2 300 km² et regroupe 74 communes au croisement de l’arc méditerranéen et alpin.
- Créée à l’initiative du Parc national du Mercantour et du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin (2021)
- Zone rurale préservée avec une faible pollution lumineuse, idéale pour l’observation astronomique.
Parc naturel régional du Vercors (2023)
- Comprend les trois quarts sud du parc, avec des zones particulièrement sombres permettant d’observer jusqu’à 3 000 étoiles à l’œil nu.
Une nouvelle opportunité pour les astronomes amateurs
La zone cœur de la RICE s’étend sur 945 km² et se situe au cœur des Landes de Gascogne, au plus haut de ce vaste plateau sableux (soit à 145 m), à la tête de 3 bassins versants : la Leyre, la Midouze et le Ciron. La qualité du ciel nocturne du coeur de la RICE mesurée s’élève en moyenne à 21,2 mag/arcsec², avec des valeurs optimales à 21,9 mag/arsec². La zone périphérique qui protège cette zone cœur, concerne quant à elle 3 818km². Les lieux permettent une observation exceptionnelle. Jusqu’à 4 000 étoiles sont visibles à l’œil nu dans cette zone, un phénomène rare dans un monde où plus d’un tiers de la population ne peut plus admirer la Voie Lactée à cause de la pollution lumineuse.
Depuis plusieurs années, le parc a mis en place différentes initiatives pour diminuer l’impact de l’éclairage artificiel :
- Adoption d’un éclairage public plus respectueux (par exemple, passage aux LED et extinction nocturne entre 1 heure et 5 heures dans certaines communes).
- Sensibilisation des habitants et des élus locaux sur les bienfaits d’un ciel sombre pour la biodiversité (oiseaux migrateurs, insectes) et la santé humaine.
Le label RICE met en avant non seulement l’importance de préserver un patrimoine naturel unique, mais aussi les bénéfices éducatifs, culturels et touristiques qu’un ciel étoilé peut offrir. Cette reconnaissance pourrait également servir de modèle pour d’autres territoires qui souhaitent s’engager dans une démarche similaire.
Cette labellisation est une fierté collective pour les Landes de Gascogne et un atout majeur pour reconnecter les habitants et visiteurs avec un ciel nocturne préservé.